Extraits de ma discussion de la session sur ce thème,
lors de la Journée des jeunes chercheurs en géographie du 13 octobre 2023
(Fruiquière, Marie, Léa Reville, Marie-Hélène Gauthier et al. 2024,
L’action dans la recherche et la recherche dans l’action : quelles imbrications ? Actes de la journée des jeunes chercheur.e.s de l’Institut de Géographie de Paris, p. 34ss)
Merci beaucoup de m’avoir invité à discuter cette session qui est très riche et pose de nombreuses questions importantes dès lors que l’on s’interroge, en tant que chercheur ou chercheuse, sur ses rapports aux acteurs enquêtés et son insertion dans l’espace social étudié, que ce soit du fait de sa conception de la recherche et de sa place dans la société, ou plus prosaïquement du fait des nécessités de l’accès au terrain. Les chercheurs en sociologie ou anthropologie s’interrogent de longue date sur le type de relations qu’ils créent et qu’ils entretiennent avec leurs différents interlocuteurs, à la fois les individus et les groupes sociaux qui sont les objets de la recherche, mais aussi les différentes institutions où ces acteurs sociaux travaillent, passent une partie de leur temps, celles qui agissent dans les espaces de vie des espaces enquêtés, celles commanditent la recherche, celles qui acceptent de l’accueillir, celles qui éventuellement peuvent se sentir mises en danger par ses résultats. Et on voit bien à travers ces trois communications que, même si cela ne fait pas directement partie de leur objet d’étude, les chercheurs en géographie sont eux-aussi obligés de réfléchir à leur position institutionnelle et ses implications, de faire de la sociologie des institutions et de la sociologie de la recherche, pour comprendre les contextes institutionnels, plus ou moins complexes, dans lesquels se déroule leur recherche, le rôle qu’ils souhaitent jouer et ceux qu’on voudrait éventuellement leur faire jouer. On voit aussi des formes très différentes de l’engagement auprès des acteurs concernés par la recherche, comme illustré par les trois communications de cette session : il peut émerger en tant qu’opportunités liées au terrain. Il peut être partie intégrante de la conception de la recherche, dans un dispositif de recherche-action complexe avec de nombreuses institutions partie prenante. Il peut résulter d’un engagement personnel par rapport aux acteurs avec lesquels on échange au quotidien, dans un contexte institutionnel, très souple, voire très informel.
Il me semble que ces trois communications illustrent bien le fait que même un chercheur externe est toujours partie prenante de l’espace social qu’il étudie, au moins pendant un certain temps, que ce soit explicite ou non, et qu’il faut réfléchir à ce que cela signifie et implique. Le simple fait d’être là modifie – à des degrés divers – le déroulement des interactions sociales que l’on observe. Les acteurs locaux vous affectent des identités ou des assignations que vous ne maîtrisez pas, ou que partiellement. Certains vont chercher à vous coopter, d’autres à se protéger. Il y a le rôle plus ou moins actif que le chercheur ou la chercheuse souhaite jouer, mais aussi ceux qu’on lui fait jouer, ceux qu’il arrive à jouer. Ces liens durent aussi au-delà du temps du terrain, jusque dans l’écriture : le fait que les écrits circulent, soient lus, parfois repris de façon plus ou moins sélective, soient instrumentalisés éventuellement, fait qu’on reste acteur de ce jeu même longtemps après avoir quitté le terrain et cessé d’y être présent physiquement. C’est évidemment très bien que les résultats de recherche circulent jusque dans l’espace social étudié, mais d’une certaine manière, cela pose des problèmes supplémentaires à l’écriture, et pas seulement dans un contexte de recherche-action où le lien avec les interlocuteurs et les utilisateurs de la recherche, et le principe de la restitution, sont présents dès le début.
Un deuxième point aussi me semble très clair à écouter ces trois communications. Les finalités et les logiques de la recherche fondamentale externe et celles des recherches partenariales au service de l’action diffèrent. Entre ces deux archétypes, il y a de nombreuses situations intermédiaires. Le terme « recherche-action » ne dit rien des proportions de l’une et de l’autre. Mais surtout ce n’est pas seulement une question de position sur un gradient. Il y a de multiples combinaisons différentes en fonction d’au moins deux critères centraux. D’un part, la finalité de la production de connaissances, entre publications académique et accompagnement du changement, que ce soit en termes d’influence sur les rapports sociaux ou sur les politiques publiques ou d’utilité pour les acteurs enquêtés dans leur maîtrise de leur devenir. D’autre part, en fonction du cadre institutionnel et partenarial dans lequel la recherche se déploie, entre le chercheur qui travaille de façon informelle, et les dispositifs partenariaux sophistiqués, avec de multiples acteurs, et de multiples contrats et flux financiers entre eux. Chacune de ces combinaisons posent des problèmes méthodologiques et éthiques spécifiques.
Les différentes questions et dilemmes soulignés dans les communications font écho à ce qu’on a appelé le tournant réflexif en anthropologie, qui résulte de cette prise de conscience de la façon dont la personnalité et l’histoire personnelle du chercheur, mais aussi la place – choisie ou assignée – que l’on occupe et le rôle – volontaire ou non – que l’on joue dans les espaces sociaux étudiés, influe sur la recherche et ses résultats, ce qui interroge les postures de recherche, la façon dont on établit et gère les relations d’enquête. Cette réflexivité est encore plus indispensable lorsque le chercheur ne se positionne pas seulement en tant qu’observateur externe, mais participe davantage à la vie sociale du groupe étudié, parfois jusqu’à la pleine participation. Lorsque d’autres acteurs ou institutions agissent dans ces espaces et produisent des savoirs, et que les savoirs produits par le chercheur peuvent les relativiser ou les mettre en cause. Lorsque, au sein même du dispositif de recherche, d’autres acteurs, d’autres institutions sont légitimes pour participer à l’analyse des situations et l’interprétation des faits étudiés, avec l’avantage de pouvoir mobiliser leurs savoirs et d’enrichir la compréhension, mais aussi le risque de qu’ils cadrent trop les questionnements ou les interprétations. Et enfin lorsque le chercheur ou la chercheuse veut, ou doit, jouer plusieurs rôles, observateur et acteur successivement ou dans le même temps.
La posture du chercheur et sa façon de penser la recherche peuvent ainsi être un premier point de discussion. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise posture en soi. Comme l’ai dit justement Léo Raymond, il s’agit avant tout de trouver sa propre bonne posture, celle qui nous correspond. Il y a en effet des postures morales et politiques variées par rapport au rôle de la recherche et à l’engagement du chercheur dans la société. Il y a des rapports variés aux institutions et à la « commande ». Il y a des positions physiques différentes par rapport à l’espace étudié, dedans, à l’extérieur, un pied dedans, un pied dehors, qui ont aussi des implications méthodologiques. Et puis on ne choisit pas toujours, parce que les recherches connaissent des contraintes de financement, des contraintes institutionnelles, des contraintes d’accès au terrain. On ne choisit pas toujours librement la position dans laquelle on se retrouve dans une recherche donnée. Il s’agit donc bien de mesurer les enjeux spécifiques à ces différentes positions, de réfléchir à la place qu’on occupe, aux relations avec les institutions, aux implications politiques et pratiques des commandes en cas de recherche sous contrat, etc. Et ensuite d’essayer d’organiser au mieux les conditions de mise en œuvre de la recherche, d’en négocier les modalités, de savoir tirer profit de la position qu’on occupe pour en tirer parti et essayer d’en minimiser les biais. Cela peut aussi amener à redéfinir ou préciser le périmètre de la recherche et ses objectifs, parce qu’on ne peut pas tout faire dans n’importe quelles conditions. Il peut y avoir des choses auxquelles on n’a pas accès, des sujets dont on ne peut pas parler ou pas n’importe comment, des durées de recherche qui ne permettent pas de vraiment traiter certaines questions. Il faut pouvoir en prendre acte, dans la définition des objectifs de la recherche et dans la politique du terrain, tout d’abord, pour conserver une démarche scientifique. Mais aussi à la fin, pour stabiliser cette fameuse problématique finale, celle qui structure la rédaction de la thèse, et qui est toujours différente de celle de départ, en particulier du fait du déroulement de la recherche et du matériau disponible.
Un deuxième point de discussion pourrait porter sur les conditions pratiques du terrain et de l’enquête, et la façon d’établir et de gérer les relations d’enquête, comment on entre et se fait accepter, comment on reste, comment on sort. On pourrait penser que plus facile pour un doctorant ou une doctorante de faire sa thèse dans des contextes de recherche-action où tout a déjà été négocié, signé etc. Mais ce n’est pas forcément plus simple pour autant. Car l’accord d’une autorité institutionnelle ne signifie pas forcément celle des autres acteurs et, si les relations sont mauvaises entre eux, cela peut même compliquer la légitimation du chercheur et du questionnement de recherche. Dès lors qu’on prend conscience des interactions multiples avec les acteurs objets ou partenaires de la recherche, qu’on considère la recherche comme un échange, il est normal de réfléchir à ce que signifie la recherche aux yeux de ces interlocuteurs, aux conditions de leur intérêt ou a minima de leur consentement à y participer, à la laisser se dérouler, et aussi aux biais éventuels. Cela pose de nombreuses questions évoquées dans les communications : celle de l’utilité éventuelle de la recherche pour ces acteurs, celle des contreparties que l’on peut donner en échange de l’acceptation des autres à vous voir là et du temps qu’ils vous consacrent, celle de l’utilisation des données et de la confidentialité, etc. Produire des cartes, apporter des informations comme l’ont fait les communicants peut être effectivement des contreparties, des contre-dons légitimes, avec toutes les questions que cela pose sur les impacts : est-ce que ça biaise ou pas ma recherche, jusqu’où puis-je m’impliquer, est-ce que je dois modifier mon objet de recherche ? Tout cela renvoie à ce qu’on appelle le pacte ethnographique en anthropologie, qui correspond au contrat, explicite ou pas, que l’on on passe avec les différents acteurs.
Un premier enjeu est de pouvoir entrer sur le terrain, de s’y faire accepter. Un second est de pouvoir y rester, face aux événements, aux éventuels blocages ou crises. Comment renégocier les objectifs de la recherche et son déroulement si l’on rencontre des obstacles ? Jusqu’où ne pas aller trop loin pour conserver l’exigence de rigueur et d’indépendance indispensables ? Un troisième est de sortir de l’espace social dont on a été partie prenante pendant quelques semaines ou quelques mois. Comment est-ce qu’on redéfinit les relations après le terrain ? Jusqu’où les conserve-t-on, avec qui et comment ? Autrefois, dans des contextes exotiques, on reprenait le bateau ou l’avion et après le terrain, les gens étaient loin et on était dans son bureau à réfléchir et à écrire, en interaction avec d’autres chercheurs. Maintenant cette distance-là n’existe plus, on fait des allers-retours, il y a WhatsApp, les interlocuteurs vous appellent pour donner des nouvelles de la famille ou en demander, pour informer des derniers événements, pour solliciter une aide, etc. La sortie n’est plus aussi nette, on peut suivre à distance des enquêtes, ce qui est un atout, au risque de ne pas clore l’enquête, de ne pas reprendre la distance interprétative nécessaire. Et puis il y a toute la question de la restitution, de la façon de rendre disponibles les résultats de la recherche, parce que ça a aussi des enjeux importants, et pas seulement dans des dispositifs de recherche-action.
Une troisième point possible de discussion, c’est la tension entre objectif de production scientifique, de connaissances académiques et objectif d’utilité sociale ou « pour l’action », avec la question de l’éventuelle division du travail au sein d’une équipe : ce n’est en effet pas la même chose lorsque cette ambition est portée directement par le chercheur ou le doctorant, ou si le chercheur ou le doctorant s’inscrit dans un programme plus large avec d’autres acteurs, d’autres sociologues, qui prennent en charge cette question de la restitution, de la communication, de la traduction en savoirs actionnables. Deux points sont importants à cet égard. Tout d’abord, il faut accepter que les savoirs qui sont les plus utiles pour l’action, pour les acteurs concernés, ceux qui permettent d’enclencher des prises de conscience, qui font bouger les représentations ou les pratiques, qui enclenchent des dynamiques de changement, ne sont pas forcément les savoirs académiques. De ce fait, les logiques de production et de validation des savoirs ne sont pas les mêmes selon la finalité qu’on leur donne. Cela pose la question de la place de la production de savoirs répondant aux exigences académiques dans des dispositifs qui se veulent, à des degrés divers, de recherche-action, de leur articulation éventuelle à d’autres formes de production de savoir (réflexions collectives) et de leurs modalités de restitution/traduction auprès des acteurs engagés dans l’action ou dont la contribution est nécessaire pour les dynamiques de changement souhaitées.
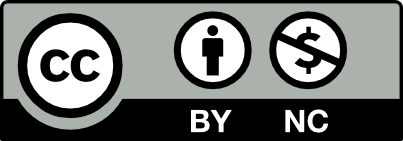
Droit d’auteur : cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.