Version revue d’une intervention lors d’un panel.
Colloque AFRIGI XAM XAM, AFRIQUES SAVANTES,
LASPAD/UGB, Dakar, 8 décembre 2025.
Merci à l’équipe du LASPAD et de Global Africa de m’avoir invité à participer à cette table ronde. Mes champs de recherche m’ont amené à réfléchir depuis assez longtemps à la question de la pluralité des normes et du legs colonial dans les politiques foncières et leurs conséquences sur la question des réformes foncières contemporaines, et aussi à celle des inégalités de pouvoir entre acteurs dans les situations de développement. Mais je dois reconnaître que j’aborde les questions de décolonialité depuis relativement peu, grâce à Global Africa en particulier (Cahen, 2025), avec à la fois curiosité et interrogations, et à partir d’une préoccupation centrale sur les traductions pratiques de ce questionnement, en termes de façons de concevoir et mettre en œuvre des recherches.
Mes lectures sur ce sujet, en particulier celles liées aux travaux latino-américains qui ont fondé les approches décoloniales, sont partielles. Elles m’amènent cependant à trois réflexions. La première porte sur l’état des savoirs. La critique décoloniale est fondamentale dans un double sens : d’abord, l’enjeu de l’affirmation d’une recherche africaine autonome dans ses problématisations, capable de rendre compte de façon solide et pertinente du continent et de ses dynamiques, ne se discute pas. Et cela a des implications fortes, épistémologiques et méthodologiques, mais aussi en termes d’écosystème de recherche, de financement, etc. Ensuite, cette critique est fondamentale au sens où elle s’adresse aux fondements même des recherches portant sur le continent. L’ambition de refondation est très élevée, et sans doute pour cette raison même, elle est souvent très abstraite. Et je m’interroge parfois sur ce qu’elle implique par rapport à l’état des savoirs : la critique décoloniale semble parfois considérer que tout est à faire, et donc que tous les savoirs actuels sont enfermés dans la « bibliothèque coloniale ». Depuis Balandier au moins, il existe de nombreux travaux majeurs sur l’Afrique, très riches, qui cherchent à lire les sociétés africaines pour elles-mêmes. Qu’ils soient tous marqués à des degrés divers par des disciplines, des époques, des postulats, c’est évident, mais c’est le cas de toutes les recherches. Est-ce au point de devoir être mis en cause ? Les savoirs produits sur l’Afrique par les grands auteurs sont-ils tellement marqués par des biais liés à une colonialité du savoir ? Quels sont les biais conceptuels et les impasses en termes de questionnements de « La société wolof » d’Abdoulaye Bara Diop ? des « Portes de l’or » d’Abdoulaye Bathily ? de la Postcolonie de Mbembé ? de l’Etat au Cameroun de Bayart ? des travaux de Villalon sur l’islam ou d’Abdou Salam Fall sur la pauvreté ? de ceux du Lasdel sur les services publics ? ou encore des nombreux ouvrages collectifs sur le Sénégal coordonnés par le regretté Momar Coumba Diouf et qui sont depuis plus de 30 ans des repères pour moi ? Un bilan critique approfondi de cette riche littérature, prenant acte de la diversité des problématiques traitées et des approches, ne serait-il pas une étape utile pour mettre en lumière ces biais et ces impasses, et au-delà d’un positionnement global, ouvrir de nouvelles questions empiriques précises, porteuses de résultats originaux et novateurs ?
Ma seconde réflexion porte sur la question des méthodes de recherche et celle des rapports entre savoirs des acteurs d’en bas (qu’on les appelle locaux, endogènes, populaires, vernaculaires, d’usage, expérientiels, voire citoyens, etc.) et savoirs scientifiques, qui est au cœur de l’ambition de refondation. Il me semble à lire certains travaux qu’il y a une tendance à opposer une « science occidentale » et « les savoirs populaires du Sud ». Cela me pose question, car d’une part il n’y a pas « une » science occidentale, mais des disciplines variées qui ont leur propre histoire et leurs propres paradigmes. L’anthropologie et la physique nucléaire ont-elles vraiment tant de choses en commun ? L’économie orthodoxe mathématisée a-t-elle vraiment à voir en termes épistémologiques avec les différentes économies hétérodoxes qui assument que l’économie est une science sociale ? Et d’autre part, même s’il y a évidemment des liens, il me semble important de dissocier le débat sur les cadres théoriques et interprétatifs de celui des méthodes, qui me semblent partiellement autonomes : la même démarche ethnographique peut produire une ethnologie coloniale à la Griaule ou une anthropologie collaborative à la Marie Miran, s’intéresser aux rituels et aux rapports aux non humains comme passer à côté. Ce qui pose la question suivante : la critique décoloniale des biais dans les problématisations des sciences sociales met-elle en cause les démarches de recherche empirique elles-mêmes et jusqu’où ? Cette question se pose en particulier pour l’anthropologie qui est à la fois la discipline qui a le plus clair passé colonial et celle qui a fait le plus d’efforts pour s’en distancier, sans doute imparfaitement, et de façon très différente selon les recherches. En quoi, au-delà des postulats et des cadres théoriques, les démarches empiriques sont-elles questionnées et mises en cause par la critique décoloniale ? et quelles réponses méthodologiques y apporter ?
Une question centrale porte sur le rapport aux savoirs, et je dirais aussi aux représentations, aux aspirations sociales, avec leur diversité et leurs contradictions. Car les savoirs n’existent pas dans l’absolu, ils sont toujours incarnés dans des acteurs sociaux, des groupes sociaux, de réseaux. Les recherches sur le foncier ont mis en avant le caractère structurel de la pluralité des normes, des tensions entre conception de la terre comme ressource commune et comme objet d’appropriation, tensions qui traverse les sociétés, souvent même les groupes familiaux (entre aînés et cadets, entre filles et fils sur l’héritage), parfois même les individus eux-mêmes.
Le colloque « maîtrise de l’espace agraire et développement » (Cnrst et Orstom, 1979) date de 1979. Cela fait cinquante ans que la question des rapports entre savoirs paysans et savoirs technico-scientifiques est travaillée, en Afrique et ailleurs (Darré, 1985; Long, 1989). En tant que socio-anthropologue, la légitimité des divers modes de représentation du monde et des savoirs locaux/populaires qui y sont liés me semble évidente, de même que son corollaire, le fait que les savoirs scientifiques n’ont pas le monopole du savoir. Les savoirs agronomiques des agriculteurs, médicaux des tradipraticiens, météorologiques des agriculteurs ou des devins (Tall, Riaux et Sultan, 2023), les savoirs d’expérience de malades (Simon, Halloy, Hejoaka et al., 2019) ou de professionnels, ont une légitimité et une certaine effectivité, au Nord et au Sud. Et la science produit des résultats limités, situés, en partie marqués par une époque ou des croyances. Mais-est-ce que cela implique qu’il n’y a pas de différence entre ces différentes formes de savoir ?
Je sens parfois une tendance à vouloir les mettre sur le même pied, à considérer que ces savoirs populaires sont « scientifiques », et que les résultats de recherche, parce que situés, sont de simples opinions, liées à la positionnalité de celui qui les formule. Est-ce vraiment la bonne façon de les légitimer ? La science est un mode spécifique de production de savoirs, qui repose sur un travail d’interprétation croisant cadres théoriques et matériaux empiriques, produits par des démarches spécifiques visant à les objectiver, et soumis à des modes spécifiques de validation par les pairs, qui en fait des produits collectifs. C’est ce qui fait sa spécificité, sa richesse, mais aussi sa limite (au-delà de celles qui sont liées aux cadrages et aux problématisations) : elle ne peut pas tout appréhender. S’il n’y a pas un effort réglé de systématisation et d’objectivation, peut-il y avoir science ? Les savoirs d’expérience des malades sont très riches. Ils disent des choses que la recherche médicale ne connait pas. Mais ils ne deviennent proprement scientifiques que s’ils passent par des démarches de systématisation et de mise à l’épreuve, qui ne sont pas celles, tout aussi légitimes, de leur validation en tant que savoirs expérientiels.
Reconnaître que les savoirs scientifiques ne sont pas de même nature que les savoirs locaux ou populaires ne veut pas dire qu’ils sont supérieurs. Et c’est plutôt dans le dialogue et la confrontation respectueuse qu’émergent des perspectives nouvelles. Cela ouvre à des réflexions très riches sur les potentialités des formes de recherches en partenariat et de coproduction de savoirs, en particulier lorsqu’il s’agit de travailler ensemble à des problèmes sociaux. Mais cela n’annule pas selon moi la différence entre savoirs scientifiques et savoirs populaires/professionnels/citoyens. Les expériences de recherche-action ont montré que les savoirs qui sont utiles, qui permettant aux acteurs sociaux de mieux comprendre les situations qu’ils vivent et leur donnent des leviers pour renégocier leur position ne sont pas nécessairement ceux qui répondent aux critères scientifiques. Créer les conditions de synergies entre acteurs et entre savoirs demande de bien travailler les modalités du dialogue, les finalités de la production de connaissances et leurs modalités concrètes. Cela a des implications sur la façon de penser les recherches en partenariat, selon que l’équilibre entre production de savoirs académiques et production de savoirs au service des acteurs.
Troisième point, il me semble qu’il y a un risque dans la tendance, présente dans certains discours décoloniaux d’Amérique latine, à durcir les oppositions entre « la science occidentale » et « les épistémologies du Sud ». D’une part, je l’ai dit, l’idée qu’il y ait « une » science occidentale demande à être discutée. D’autre part, de Sousa Santos, qui a mis en avant la notion d’épistémologies du Sud (de Sousa Santos, Arriscado Nunes, Meneses et al., 2022), explique qu’il s’agit en fait avant tout d’un concept politique, contre hégémonique, visant à valoriser les savoirs des acteurs dominés, au Nord et au Sud. Et qu’il y a ainsi du Nord au Sud et réciproquement. Du coup, si le terme « Sud » a l’avantage de mettre au centre la colonialité et la question culturelle et linguistique, n’est-il pas porteur de confusions ? Parler d’épistémologies populaires ou émancipatrices ne les éviterait-il pas ?
Une telle opposition a aussi des implications conceptuelles sur ce qu’on prend ou pas en compte. Ainsi, de Sousa Santos oppose aux « conceptions capitalistes du développement reproduites par la science de l’économie conventionnelle et qui sont fondées sur l’idée d’une croissance infinie » les différentes conceptions du monde rencontrées au Sud, en termes de buen vivir ou de sumak kawsay en Amérique latine, de swadeshi en Inde, etc. et propose d’en faire des analyses comparées. Mais, outre que les théories économiques critiques de ces conceptions capitalistes existent, Aristote avait il y a fort longtemps théorisé la différence entre l’oikos, la famille ou la communauté, d’où est tiré le terme « économie » et la chrémastitique, qui est la recherche du profit, différence qui a été à la base de la critique catholique de l’enrichissement. L’économie est ainsi étymologiquement « la norme de conduite du bien-être de la communauté », loin de l’idéologie d’accumulation capitaliste. Dès lors, l’opposition n’est-elle pas d’abord entre logiques d’accumulation – poussées au paroxysme par l’économie capitaliste et à laquelle participent des élites du nord et du sud – et les différentes conceptions, dans le temps et l’espace, de la « conduite du bien-être de la communauté » sans postuler que ces conceptions soient nécessairement « du Sud » ? Sans négliger ou minimiser aucunement l’apport spécifique des conceptions du Sud, n’est-il pas aussi riche d’intégrer « l’oikonomie » à la gamme des pensées alternatives ? Ce qui n’empêche en rien de discuter leurs parentés et leurs différences, en particulier en termes de rapports aux non humains.
Voilà donc les trois réflexions que je voulais partager avec vous. Je vous remercie.
Références
Cahen, M., 2025, « Colonialité : de l’Amérique latine à l’Afrique ? (interview par Philippe Lavigne Delville et Mame-Penda Ba) », Global Africa n° 9, p. 98-105, https://doi.org/10.57832/qhje-zf75.
Cnrst et Orstom ed., 1979, Maîtrise de l’espace agraire et développement en Afrique tropicale. Logique paysanne et rationalité technique, Ougadougou/Paris Centre National de la Recherche Scientifique et Technique de la Haute-Volta & Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer.
Darré, J.-P., 1985, La parole et la technique: l’univers de pensée des éleveurs du Ternois, Paris, Harmattan.
de Sousa Santos, B., Arriscado Nunes, J., Meneses, M. P., et al, 2022, « Ouvrir le canon du savoir et reconnaître la différence », Participations, vol N° 32 n° 1, p. 51-91, 10.3917/parti.032.0051, https://shs.cairn.info/revue-participations-2022-1-page-51?lang=fr.
Long, N., 1989, Encounters at the Interface. A Perspective in Social Discontinuities in Rural Development, Wageningen Agricultural University.
Simon, E., Halloy, A., Hejoaka, F., et al, 2019, « Introduction: La fabrique des savoirs expérientiels: généalogie de la notion, jalons définitionnels et descriptions en situation », in Simon, E., Arborio, S., Halloy, A., et al, ed., Les savoirs expérientiels en santé. Fondements épistémologiques et enjeux identitaires, Nancy, Presses universitaires de Lorraine, p. 11-48.
Tall, Y., Riaux, J. et Sultan, B., 2023, « Rendre compte de l’insaisissable. Prédictions météorologiques des Saltigui Sereer (Sénégal) », Revue d’ethnoécologie n° 24.
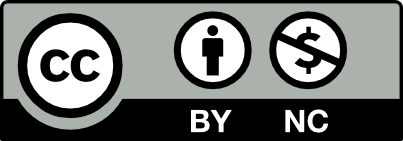
Droit d’auteur : cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
Merci Philippe pour cet apport sur la question brulante de la décolonialité !